|
|
|
|
|
|
Régime alimentaire et maladie de crohn...
14/09/2007 19:43
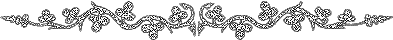
Beaucoup d'idées préconçues et/ou fausses, "circulent "à propos de l'alimentation au cours de la maladie de Crohn (MC). Il faut leur faire un sort pour éviter d'ajouter des contraintes inutiles à des patients qui en ont suffisamment par ailleurs. Voici donc quelques réflexions pratiques et simples à leur sujet :
Aucun facteur alimentaire n'a de rôle clairement établi pour l'instant dans la survenue d'une MICI si bien que le régime alimentaire n'a pas, en général, pour objectif de "traiter" voire de "guérir" ou "d'empêcher la rechute" de la maladie mais simplement de diminuer ou de faire disparaître certains symptômes de la maladie.
Dans la grande majorité des cas, les lésions inflammatoires sont limitées à la partie terminale de l'intestin grêle (iléon) et/ou au gros intestin (côlon) et les capacités de digestion et d'absorption sont donc tout à fait conservées ce qui doit permettre de conserver un bon état nutritionnel.
Le régime doit ainsi être adapté aux symptômes de la maladie et à l'état nutritionnel du patient. Il est donc différent chez chaque malade selon que sa maladie est en "poussée évolutive" ou en "rémission".
Lors des phases actives de la maladie, l'alimentation a trois buts essentiels :
maintenir ou restaurer un bon état nutritionnel grâce à des apports suffisants en protéines en particulier, mais aussi en vitamines, en sels minéraux et oligo-éléments ;
diminuer la diarrhée quand elle existe, d'où un régime pauvre en fibres alimentaires et en lactose appelé aussi "sans résidus" ;
contribuer à obtenir la mise en rémission : c'est le rôle, dans certaines formes sévères, de l'assistance nutritionnelle : NEDC (nutrition entérale à débit constant) ou NPT (nutrition parentérale totale) ; leur mode d'action précis est mal connu mais la "mise au repos" plus ou moins importante du tube digestif joue le rôle essentiel. Les techniques d'assistance nutritionnelles sont très utilisées chez l'enfant et l'adolescent car elles ont un effet très positif en cas de cassure de la courbe staturo-pondéral.
Dès la rémission obtenue et pendant toute la phase de quiescence, le régime alimentaire doit être progressivement "élargi" pour se rapprocher le plus possible d'une alimentation normale ce qui est possible dans la plupart des cas. Les fibres alimentaires sont ainsi réintroduites petit à petit selon la tolérance de chacun. Elles sont, en général, bien supportées dans ces conditions sauf intolérance propre à chaque individu. Il faut, bien sûr, éviter leur consommation excessive par exemple en été ou limiter celle de certaines fibres dures (céleri, radis, vert de poireau... par exemple). L'expérience clinique montre que beaucoup de patients restent de manière prolongée à un régime sans résidus par crainte de voir réapparaître leurs symptômes plutôt que par nécessité. Or, le régime sans résidus est très monotone, favorise la prise de poids et tout doit être fait pour se rapprocher le plus possible d'un régime normal ; mieux vaut, si nécessaire, prendre de petites doses de ralentisseurs du transit et élargir le régime que l'inverse. La tolérance des laitages est variable d'un malade à l'autre. Elle dépend également de leur teneur en lactose (sucre propre du lait). Celle-ci est surtout élevée dans le lait lui-même mais il est souvent possible d'en consommer 100 à 200 ml par jour et dans le fromage blanc. En revanche, la teneur en lactose est beaucoup plus faible dans les yaourts et surtout dans les fromages d'où le lactose a presque disparu et qui peuvent être consommés sans restriction quels qu'ils soient sans se limiter aux seules pâtes cuites ou pressées. Des apports alimentaires en calcium sont en effet très importants pour prévenir la décalcification (ostéopénie, ostéoporose) si fréquente dans cette maladie.
Le régime sans sel strict n'est pas justifié en cas de traitement par les corticoïdes. Il n'est nécessaire que dans certains cas particuliers comme chez les sujets âgés ou en cas d'hypertension artérielle ce qui est très exceptionnel dans la population habituelle des sujets jeunes atteints de maladie de Crohn. La restriction en sel doit être très modérée et il suffit en général d'éviter les excès de sel. Le régime sans sel n'a malheureusement aucun effet préventif ni sur la prise de poids, ni sur le gonflement du visage que l'on peut observer chez certains patients sous corticoïdes.
Chez certains opérés, après une résection intestinale étendue ou en cas de stomie, on peut observer une diarrhée importante avec des selles non seulement fréquentes mais aussi de volume important. Cette diarrhée entraîne parfois des pertes importantes en eau et électrolytes (sodium, potassium...) qu'il faut donc compenser et augmentant suffisamment les apports alimentaires d'eau et de sel en sachant que le meilleur critère d'efficacité est l'obtention d'une diurèse normale. La diarrhée peut aussi s'accompagner d'un trouble de l'absorption des nutriments qui peut nécessiter une adaptation de la quantité des graisses dans l'alimentation et une supplémentation en vitamines (B12, acide folique, D en particulier) et en sels minéraux (calcium, magnésium surtout). Quand le trouble d'absorption des graisses est très important il faut en plus réduire les apports en oxalates (épinards, betteraves, chocolat, thé et Coca-Cola en particulier) pour diminuer le risque de calculs urinaires d'oxalate de calcium.
En définitive, l'objectif est de limiter les contraintes inutiles pour s'attacher à prévenir les éventuelles carences induites par un régime inadapté.
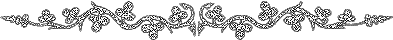
| |
|
|
|
|
|
|
|
La coloscopie...
14/09/2007 19:47

La coloscopie totale permet d'explorer tout le colon et même une partie de l'intestin grêle.
La préparation à l'examen :
La coloscopie totale demande une préparation du colon ; elle doit être la meilleure possible pour que l'examen soit de qualité et apporte les informations nécessaires. Il faut que le colon soit vidé de son contenu. Le patient aura un régime sans résidu et ingèrera la veille de l'examen un liquide de lavage intestinal qui provoquera une vidange colique parfois profuse.
Au moment de la coloscopie, il est indispensable d'être à jeun (ni boire, ni manger, ni fumer) depuis plusieurs heures à cause de l'anesthésie.
Les complications de la coloscopie :
Les complications sont rares.
Une anesthésie générale n'est jamais anodine, il y a toujours un risque, que l'anesthésiste évaluera avec vous au moment de la consultation.
Pendant la coloscopie, le médecin pourra faire des biopsies voire enlever un ou des polypes.
Ce geste peut rarement entraîner une perforation intestinale.
Si elle est diagnostiquée au cours de la coloscopie, une intervention sera entreprise pour réparer immédiatement la brèche et laver le péritoine.
Si elle n'est diagnostiquée que dans les heures ou jours qui suivent l'examen coloscopique, il faudra pratiquer une intervention chirurgicale pour traiter la plaie. Il sera peut-être nécessaire de réaliser une colostomie temporaire (colon abouché à la peau) le temps que la plaie colique se cicatrise bien.
Une infection demeure possible malgré toutes les précautions prises.
Une perforation intestinale est aussi possible, une intervention sera alors peut-être nécessaire.
Une hémorragie est aussi possible.
Quelles précautions prendre après la coloscopie ?
Après la coloscopie, vous resterez hospitalisé quelques heures et il est conseillé de ne pas prendre sa voiture en sortant car les produits anesthésiques ne sont pas totalement éliminés.
Si dans les jours qui suivent l'examen vous avez des douleurs abdominales, du sang dans les selles, de la fièvre, un malaise, contactez sans délai le médecin qui aura pratiqué l'examen ou l'anesthésiste.
Quelles informations donner à votre médecin ?
Vous aurez une consultation avec un anesthésiste avant l'examen, dites lui si vous avez une maladie particulière par exemple des allergies, de l'asthme, une maladie cardio-vasculaire ou respiratoire...
Si vous prenez un traitement particulier, la préparation colique avec le liquide de lavage peut modifier l'activité du médicament. Ne manquez pas de le signaler à la consultation.
Combien de temps dure l'examen ?
L'examen dure peu de temps, environ 30 minutes.
Si vous avez subi une anesthésie générale, vous resterez hospitalisé quelques heures en observation.
| |
|
|
|
|
|
|
|
Qu'es-ce que le traitement chirurgical de la maladie de crohn ?
17/09/2007 10:43
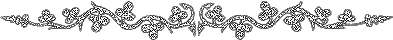
La maladie de Crohn est habituellement bien contrôlée par le traitement médicamenteux.
Le traitement chirurgical intervient lorsque le traitement médicamenteux ne suffit pas ou si les doses nécessaires entraînent des effets secondaires trop gênants ou lorsque certaines complications de la maladie surviennent.
Quel est le principe de l'intervention ?
En pratique, l'intervention consiste à supprimer la partie atteinte de l'intestin et à réunir les deux extrémités saines. C'est la résection.
La maladie de Crohn peut atteindre, de façon plus ou moins étendue, tous les segments du tube digestif (intestin grêle, colon, rectum). Selon la localisation et l'étendue de la partie atteinte, la résection sera plus ou moins importante.
Lorsque le côlon et/ou le rectum sont atteints, le geste chirurgical est identique à celui réalisé en cas de Recto-colite Hémorragique, sans conséquence majeure.
Si l'intestin grêle est atteint, on essaye de limiter au maximum les segments intestinaux enlevés. En effet, l'intestin grêle est indispensable à la digestion des aliments, on pratique donc ce qui est appelé une résection « économe ».
Quels sont les résultats ?
Après l'intervention le patient retrouve un état général nettement amélioré et le traitement médicamenteux pourra généralement être allégé.
Toutefois des récidives restent possibles : la totalité de la muqueuse digestive n'ayant pas été retirée, l'inflammation peut réapparaître. C'est pourquoi, un traitement médical de prévention des rechutes est souvent mis en place.
Si une partie importante de l'intestin grêle a été retirée, des troubles nutritionnels risquent d'apparaître. Ils peuvent être compensés par un régime alimentaire, des techniques de nutrition et/ou un traitement médicamenteux adaptés.
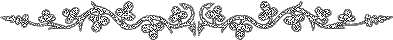
| |
|
|
|
|
|
|
|
Burril Bernard CROHN
17/09/2007 10:50

Gastroentérologue américain, né en 1884, mort en 1956.
En 1932, Burril B. Crohn, médecin américain, a donné son nom à la maladie en décrivant 14 cas de l'affection localisée à la moitié terminale de l'intestin grêle (iléon). Il a mis en lumière la spécificité des lésions laissées par la maladie. Par la suite, on a pu constater que ces lésions spécifiques pouvaient être localisées à différents endroits des intestins, bien que 40 à 50% des cas soient localisés à l'iléon (iléite régionale-terminale).
Au moment il a décrit "sa" maladie, en 1932, Crohn était médecin à l' Hôpital du Mont Sinaï où il a travaillé avec le neurologue Bernard Sachs (1858-1944). Là il a bientôt construit une très grande et prospère réception pour les malades atteints d'entérocolite où il est devenu chef du département de gastroentérologie. Il a soigné des malades venant de tous les USA, et même d'Europe.
Crohn a été professionnellement actif jusqu'à l'âge de 88 ans.
| |
|
|
|
|
|
|
|
Association François Aupetit - AFA -
17/09/2007 10:58

L'organisation française se consacre au soutien et au développement de la recherche sur la maladie de Crohn et les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Son objectif prioritaire est de susciter et financer des programmes de recherche fondamentale, clinique et thérapeutique sélectionnés par son comité scientifique avec également une préoccupation, celle de permettre aux malades et leur famille un échange d'informations et de services au travers de ses délégations régionales et de ses rubriques d'entraide et de dialogue.
Site très complet, toute l'actualité sur la maladie (revue de presse, congrès, article, ...).
| |
|
|
|
|